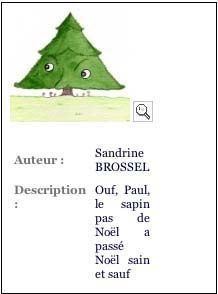Elle s'écrit
Audrey Jordan
Lundi
Elle était belle ma solitude. Sombre et légère. Elle n’appartenait qu’à moi, je n’appartenais qu’à elle. Et je connaissais ce sentiment de puissance…
— Vous désirez autre chose ?
Anaïs releva la tête, agacée. Un serveur se tenait devant elle, affichant un sourire qui se voulait avenant.
— Un autre café, s’il vous plaît.
L’homme acquiesça et regagna le bar. Voilà ! Elle avait perdu sa phrase ! Une demi-heure qu’elle écrivait frénétiquement sur son carnet, ce qui avait au moins le mérite d’intriguer fortement son voisin, et l’irruption d’un serveur au mauvais moment avait interrompu le fil de ses pensées. Et Dieu sait qu’il était fragile ces derniers mois ! Elle avait vu cette annonce sur le net pour un fanzine. Le thème, c’était la solitude. Elle avait bien pensé, au début, envoyer quelques vieux poèmes car sur le sujet, elle en avait écrit plusieurs ; mais elle s’était finalement dit que c’était une bonne occasion pour exercer à nouveau sa plume. Deux ans qu’elle n’avait pas proposé de nouvelles à un magazine, il était plus que temps de s’y remettre. Voilà donc comment elle s’était retrouvée attablée, seule, dans ce café. Il était dans sa rue et pourtant, c’était la première fois qu’elle y mettait les pieds.
Trois ans, maintenant, qu’elle s’était installée dans ce quartier. Elle avait vécu en autiste. Elle ne savait rien de ses voisins, simples bonjours polis échangés le matin sur le palier. L’épicerie du coin était son seul paradis, elle avait investi cet endroit qui embaumait les odeurs de son enfance, pour seule sortie quotidienne. Bien sûr, c’était plus cher que dans les supermarchés mais elle n’aimait pas la foule, elle avait l’impression d’étouffer. Marc s’occupait chaque semaine, du « gros », il s’arrêtait à la grande surface la plus proche et arrivait à la maison les bras chargés de courses tel son sauveur. Il n’oubliait jamais sa cartouche de cigarettes achetée sur le chemin du retour. Grâce à lui, elle pouvait continuer à s’enfumer les poumons sans jamais dépasser la place Beaumont qui clôturait sa rue. Et si, aujourd’hui elle s’était décidée à agrandir son univers, ce n’était pas qu’elle souffrait de cette maladie humaine que l’on nomme l’ennui. Elle avait été poussée dehors par ces maudits travaux engagés dans l’appartement en dessous de chez elle. Une semaine que ce vacarme permanent l’empêchait d’écrire. Enervée, elle avait quitté son domicile en claquant la porte, emportant son carnet sans idée précise. Elle avait d’abord pensé à aller au parc mais l’idée de prendre le bus qui, à cette heure de pointe, devait être bondé, l’avait arrêtée. Elle avait repéré ce petit café caché derrière un salon de coiffure, presque vide. C’était parfait. Ici, elle trouverait le calme auquel elle aspirait. Elle s’y était installée et avait commandé un café.
Une tasse se posa comme par magie sous son nez. Anaïs sursauta :
— Merci, murmura-t-elle machinalement sans relever la tête.
Il fallait qu’elle fasse une pause, elle commençait à avoir mal à la tête. Trop de choses bourdonnaient dans son esprit. Des personnages, des actions, des paroles, comme un essaim d’abeilles. Elle but son café rapidement et s’alluma une cigarette. Son regard se posa sur la baie vitrée. Dehors, il commençait à pleuvoir. Elle regarda sa montre, il fallait aller chercher les petits à l’école. Elle rangea ses affaires, se dirigea vers le comptoir pour payer et sortit dans la rue.
Mardi
Marc était malade. Il avait la grippe comme pratiquement tout le monde, en cette saison. Anaïs regardait la liste de courses accrochée sur le frigo depuis un bout de temps, maintenant. Elle ouvrit la porte : une bouteille de lait et une plaque de beurre. Rien à faire, il était toujours désespérément vide. Elle se mit à rire. Bien sûr, elle était stupide. Il n’allait pas se remplir tout seul ! Elle décrocha le papier d’un geste énergique et prit ses clefs de voiture. C’était ridicule ! De quoi avait-elle si peur ? Aller dans un supermarché, ce n’était pas si terrible ! On était en semaine, en pleine journée, il n’y aurait personne aux caisses, elle aurait bouclé l’affaire en une demi-heure…
La route était déserte, elle mit à peine dix minutes pour se rendre au centre commercial. Elle se gara loin des autres voitures. Elle n’avait jamais réussi à faire un créneau correct et préférait que la place voisine soit libre. Anaïs contempla le monstre aux enseignes lumineuses. Il ressemblait à un hôpital. Seules ces pancartes publicitaires rappelaient son appartenance au monde commercial. Un grand bâtiment blanc qui déployait ses galeries marchandes comme des tentacules. Un énorme poulpe informe. Cette dernière réflexion déclencha chez elle un rire clair et fort. Un vieil homme qui passait à côté de la voiture s’arrêta pour la dévisager avant de continuer son chemin. Elle rougit. Sans doute l’avait-il prise pour une folle ? Elle ouvrit la portière et descendit.
Elle parcourait les rayons, fiévreuse, son pull lui collant au corps. C’était beaucoup trop grand et il faisait beaucoup trop chaud. Elle n’arrivait pas à trouver les articles inscrits sur cette maudite liste. Voilà une heure qu’elle tournait en rond, essayant d’appréhender l’agencement du magasin, en vain. Pour elle, il n’avait aucune logique. Elle s’arrêta un moment devant les yaourts pour profiter un peu de la fraîcheur et reprendre ses esprits. Ce n’était tout de même pas sorcier ! Tout le monde faisait ses courses, il fallait qu’elle se calme, elle n’était pas plus stupide qu’une autre…
— Vous allez bien, madame ?
Un homme d’une trentaine d’années se tenait devant elle, son nom était épinglé sur sa chemise : Nicolas.
— Oui, oui, ça va. Merci. C’est juste qu’il fait une chaleur horrible dans ce magasin !
— Je vous suggère de vous arrêter au Coin café sur votre droite afin de vous désaltérer. Bonne journée, madame.
Anaïs le regarda s’éloigner, ahurie. Un café dans un supermarché ? En voilà une idée bizarre ! Il y avait donc des gens assez fous pour aimer faire leurs courses au point d’y passer leurs journées ? En tout cas, elle, elle avait eu sa dose. La prochaine fois, elle penserait à se faire livrer.
Elle retrouva la sortie tant bien que mal, se rendant compte arrivée à la caisse qu’elle avait pris trois packs de yaourts et oublié le shampoing. Epuisée, elle n’eut pas le courage de revenir en arrière. Elle passa à la caisse rapidement et jeta pêle-mêle ses courses dans le coffre, pressée de quitter au plus vite cet enfer.
Elle était rentrée chez elle et regardait la télévision lorsque la sonnette retentit. Elle se leva en râlant pour aller ouvrir. C’était sa voisine.
— Je me suis permise de ramener Lucas et Alice comme vous étiez en retard…
Elle avait oublié ses enfants à l’école ! Comment avait-elle pu oublier une chose pareille ?
— Je suis confuse, bafouilla-t-elle, effondrée.
La femme lui lança un regard inquisiteur et poussa vers leur mère deux enfants en larmes. Anaïs s’écarta pour les laisser entrer.
— Je suis vraiment désolée. Mon mari et moi, nous avons la grippe et nous nous sommes endormis. Je vous remercie.
— Y a pas de quoi, répondit-elle froidement, bonne soirée.
Une fois la porte fermée, Anaïs fit face à ses enfants.
— Maman est désolée…
Mais elle assista impuissante à la fuite de sa fille qui gagna sa chambre en courant. Que devait-elle faire ? La suivre pour la consoler ?
— Maman ? Je peux regarder la télé ?
— Oui, bien sûr mon chéri.
Son fils se précipita sur la télécommande et s’empressa de lui tourner le dos, captivé par un dessin animé.
Mercredi
Marc était mort dans la nuit. Une attaque. C’était à peine compréhensible. Hier encore, il allait bien, un peu grippé comme tout le monde mais rien de grave. Et puis, ce matin, elle l’avait trouvé inerte dans le lit, dans leur lit. Elle n’avait rien entendu, rien pu faire. Comment allait-elle annoncer cela aux enfants quand ils sortiraient de l’école ? Heureusement, sa mère devait arriver d’un moment à l’autre. Elle tournait en rond dans l’appartement, désoeuvrée. Comment se comporte une femme qui vient de perdre son mari, son dernier refuge contre la vie ?
Elle se laissa tomber, lasse, sur un fauteuil. Attendre. Elle allait attendre. Peut-être que le temps reviendrait en arrière. Peut-être qu’il s’était trompé de roue et qu’elle se réveillerait auprès de son époux, sa respiration serait paisible. Elle pourrait suivre les battements de son cœur en les collant aux siens. Une seule et même personne, sa force et sa fragilité à elle réunies à chaque coup.
Je l’aimais. A ma manière, mais je l’aimais. Il était mon soutien, l’épaule sur laquelle pleurer. Il était mon rire, ma chair, mon corps. C’est pour lui que j’étais femme, pour lui que j’étais mère. Je ne suis plus rien désormais. Le peu de flamme qui me restait s’est éteint dans les larmes que j’ai versées. Une rage sourde hurle en moi mais mon corps reste inerte. Je ne peux que donner cette apparence d’indifférence. La douleur anesthésie les sens. Ils pourront me croire cruelle, sans cœur. Que savent-ils de l’Amour qui déchire mes entrailles ? Il faudrait que je me donne en spectacle, que je hurle, que je frappe, pour que mes sentiments soient plus forts ? Je l’aimais, je l’aime encore car la mort ne tue rien. Elle n’est qu’absence, absence de l’autre. Absence de soi.
Jeudi
Je me sens si seule, désormais. Une rivière isolée sur une terre aride.
Anaïs jeta le carnet sur le fauteuil, en rage. Pourquoi continuait-elle à écrire cette satanée nouvelle, maintenant ? Quel intérêt ? Des larmes amères coulaient sur ses joues. Tu m’as oubliée, tu m’as abandonnée, Marc. C’est injuste. Tu sais bien que je suis trop fragile pour affronter la vie seule. Je te déteste ! Pourquoi tu m’as fait ça ? Et les enfants ? As-tu pensé aux enfants ? Que vont-ils devenir avec une accidentée de la vie comme moi ?
Elle essuya son visage sur sa manche, renifla un grand coup et ramassa son carnet. Il fallait qu’elle finisse cette nouvelle coûte que coûte. Elle ne savait pas pourquoi mais il fallait qu’elle finisse.
Il n’y avait plus d’espoir. Le monde l’avait engloutie pour la recracher, ensuite, dans une nausée de Haine. Une tache de vomi sur le sol, voilà ce qu’elle était. Tout le monde s’écartait de son chemin avec un profond dégoût. Et pourtant, parfois, elle aimait cela…Vivre dans le rejet… Elle éprouvait un tel sentiment de puissance dans sa solitude, d’orgueil. Oui, être différent, ne pas se fondre dans la masse…Mais n’était-ce pas que mensonge, illusion, pure création de son esprit afin de rejeter la souffrance dans les méandres du dédain ? Etre seule et n’aimer personne afin de ne jamais connaître Déception, déesse du solitaire ? Si elle n’approchait personne, ses remparts resteraient intacts, inviolés, son palais ne souffrirait jamais l’hypocrisie, l’abus ou le pouvoir.
Mais ne manquerait-il pas quelque chose ? Oui, mais quoi ? Quoi de si précieux, de si indispensable à sa vie ? L’amitié, deux cœurs qui battent à l’unisson ? Des mots qui s’avancent et se retirent ? Des mots qui se cherchent et se déguisent ?
Des mots qui n’ont pas besoin d’être prononcés.
La lumière du jour commençait à baisser. Elle plissa les yeux pour déchiffrer l’horloge, elle avait oublié de mettre ses lunettes. Il devait être cinq heures. Dans un quart d’heure, sa mère allait arriver, viendraient ensuite les amis et la famille qui habitaient loin et passeraient la nuit chez elle. Demain, onze heures, on enterrerait Marc. Elle aurait voulu quelque chose d’intime mais sa famille avait insisté pour tout organiser. Elle avait fini par accepter avec soulagement, elle ne s’en sentait pas la force et puis, l’enterrer si vite… Maintenant, elle regrettait de ne pas avoir pris les choses en main. Accueillir toutes ces personnes chez elle ne l’enchantait guère. Heureusement, sa mère serait là. Une petite voix pleine de sanglots coupa sa réflexion :
— Maman ? Je veux….Papa !
Sa petite fille se tenait devant elle, serrant un lapin en peluche de toutes ses forces entre ses bras potelés. Les larmes baignaient son visage. La crise n’était pas loin. Anaïs ferma les yeux. Il fallait faire quelque chose, vite. Oui, mais quoi ? Lui répéter que son papa était mort et ne reviendrait pas ?
— Tu veux un verre de lait ma chérie ?
Elle voyait déjà la scène avec horreur. Dans quelques minutes, elle se mettrait à hurler. Ce serait l’enfer et elle ne saurait pas quoi faire. Une fois de plus, elle resterait paralysée devant les cris de sa fille sans pouvoir établir le dialogue. Mais la crise tant redoutée ne venait pas. Ses larmes coulaient en silence. C’était encore plus effrayant. La tête lui tournait. Son enfant reculait devant elle. La porte claqua. Sa mère entra les bras chargés de course et se dirigea vers la cuisine. La petite fille se précipita à sa suite pour chercher le maigre réconfort qu’elle-même n’avait pas su lui offrir.
Anaïs secoua la tête dans un mouvement de désespoir. Il était tant qu’elle se remue. Il fallait qu’elle le fasse pour eux. Plus personne désormais ne serait là pour faire les choses à sa place.
Elle se leva d’un pas décidé et se regarda dans le miroir. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis, on lui aurait facilement donné dix ans de plus. Anaïs saisit la trousse bleue qui traînait sur la console au dessous du miroir et entreprit de se maquiller.
Vendredi
Il aurait fallu de la pluie pour un enterrement, elle s’accorde mieux à notre chagrin. Mais ce jour-là, le soleil aveuglant semblait nous narguer. Comme si la mort n’avait pas de carte de séjour, la vie investissait tout.
Anaïs était absente, perdue dans ses souvenirs. Elle sursauta quand les gens commencèrent à se diriger vers leur voiture. C’était donc déjà fini ? Si simple que cela ? Une vie enterrée, deux ou trois mots prononcés et la vie reprenait ses droits. Elle regarda son fils sourire à une parole de son oncle. Mon Dieu ! Comme elle aurait voulu ne jamais grandir ! Se jeter dans les bras de sa mère et s’y réfugier. Mais elle n’était plus une enfant, les autres la jugeraient et se moqueraient de sa faiblesse.
Elle resserra son manteau sur elle pour essayer de vaincre le froid qui envahissait son cœur. La pancarte devant elle indiquait « allée des tilleuls », ça serait désormais sa dernière résidence. La rue de son enfance portait le même nom. Là où elle avait vu son mari pour la première fois, sur son vélo, le pantalon et les joues barbouillés de boue… Quelle ironie ! La vie se joue de nous, disait sa grand-mère, elle se joue et nous abuse, afin de nous cacher sa nature profonde. Qui supporterait de savoir que tout ceci n’est qu’une mascarade ? C’est pour cela, que le mensonge est une des premières qualités de l’Homme.
Comme elle avait raison ! En une nuit, le décor s’était écroulé. Le décor d’une vie. Des noëls joyeux autour du sapin, des naissances, un mariage heureux et tranquille, quelques publications dans des revues mais que lui restait-il désormais ? Des enfants qu’elle n’avait jamais pu aimer seule ? Les amis qu’elle n’avait jamais eus ? Que ferait-elle désormais ? Comment gagnerait-elle sa vie, elle, qui était trop peureuse pour franchir la place Beaumont ?
Elle était montée dans la voiture sans même s’en apercevoir. On lui parlait ou plutôt des lèvres remuaient, elle acquiesçait en silence à des paroles qui se voulaient réconfortantes mais qu’elle ne saisissait pas. Un monde de pantomimes se dressait devant elle. La voiture s’arrêtait, on rentrait à la maison, on enlevait les manteaux, une table se dressait et tout ce petit monde s’agitait autour d’elle pour simuler la vie. Mais elle n’était pas là, elle n’en faisait pas partie. Des étrangers lui lançaient des regards condescendants et elle devenait toute petite, invisible. Elle ne comprenait plus rien. Un carnet de cuir reposait sur une commode, elle le reconnaissait, il l’attirait. Mais elle ne pouvait le saisir. Pas maintenant, plus tard.
Samedi
Le plus cruel lorsque l’on pleure, ce sont ces cicatrices qui restent après l’orage. Ces yeux bouffis que je regarde dans la glace et qui me rappellent mon malheur alors que je voudrais déjà l’oublier, l’effacer de ma mémoire. J’ai appris à dormir, j’ai compris bien tôt les bienfaits de la sieste après la tempête. Appeler les marchands de sable, faux marchands de rêves, qui n’apportent que cette petite mort où l’esprit s’oublie un instant dans les méandres du sommeil. Je comprends l’attrait de la mort. Prolonger cela à l’infini lorsque les tempêtes se succèdent sans jamais laisser de répit, quelle tentation !
La solitude n’est pas un choix de vie, c’est un point de fuite. On dresse des remparts, on bâtit une tour et on s’y enferme mais on espère toujours que quelqu’un va nous en délivrer. En vérité, personne ne vient jamais car on a trop pris soin de jeter la clef aux oubliettes. Les mots de passe pour entrer sont trop compliqués et même le plus téméraire se décourage. On se défend de toute culpabilité par orgueil et aussi car il est bien difficile d’arriver à en sortir quand l’accoutumance s’est installée. J’ai peur de franchir ma porte, il suffirait que quelqu’un me tende la main…Un pas en avant, un pas derrière la ligne et à moi, la liberté ! Mais toutes les mains me semblent hostiles, elles ont été si dures celles que j’ai connues autrefois. La main qui frappait ma joue, enfant, lorsque je revenais avec une mauvaise note de l’école. La main qui me jurait fidélité et qui m’a trahie. La main qui a violé mon corsage dans la rue, un soir d’hiver…
Je comprends la tentation de la nuit, je comprends. Ma main repose sur une boîte de comprimés. Elle aussi, elle m’est hostile, elle me tente. Elle veut porter à ma bouche un goût de mort, combler ma solitude par une autre absence, qui elle, au moins, a le mérite de ne pas avoir conscience de son état. Ma grand-mère avait raison. Il est temps d’interrompre cette mascarade. Pourquoi hésiter encore ?
Dimanche
Elle regardait fixement le carnet de cuir. Qu’allait-elle faire maintenant ? Elle avait envoyé le mail ce matin, sa nouvelle était partie et elle se sentait plus désoeuvrée que jamais.
Les mots s’étaient écoulés tranquillement, toute la nuit. Ils avaient tourné les pages à sa place, une à une. Mais la vie, elle, n’avait pas encore mis le mot « fin. » La vie n’était pas faite de mots. Elle avait cru exorciser sa souffrance mais elle s’était rapidement rendue compte de son erreur. Elle n’avait pas su trouver de mots pour dire le froid qui envahissait son cœur. Anaïs alluma une cigarette. Il fallait qu’elle soit forte, qu’elle s’en sorte…Mais ce n’était pas vrai. Toutes ces belles histoires dont on abreuve les enfants….Un jour, tu verras, la vie tournera du bon côté pour toi, tout s’arrangera…Tout le monde a son instant de Bonheur…Tout était faux. Il y a des personnes, en ce monde, qui n’ont pas cette chance. C’est ainsi. Il y a des personnes qui sont toujours seules. Elle avait toujours été seule. Pourtant, elle s’était mariée, elle avait eu de beaux enfants en parfaite santé, elle n’avait connu ni la faim ni le froid. Mais rien n’avait pu combler le vide qui étreignait son cœur. Non, rien. Ses enfants lui étaient étrangers, elle n’avait jamais su être mère. Elle aurait tellement aimé courir dans leur chambre, les prendre dans ses bras, leur dire des paroles réconfortantes…Mais comment leur faire croire en la vie alors qu’elle n’y croyait pas elle-même ?
Elle avait fait sa valise sans même s’en rendre compte. Dans un état second, elle avait rejoint la gare.
— Pour quelle destination ?
— Bordeaux.
Elle avait choisi la ville au hasard. Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait faire. Fuir, c’était son idée fixe. Elle était seule dans le train. Personne n’occupait la place d’à côté. Seule, c’était toute sa vie. Elle regardait les voyageurs embarquer, le train bouger, le paysage défiler. Rien ne lui paraissait réel. Elle ferma les yeux, épuisée et s’endormit.
Lundi
Sa mère l’avait découverte morte dans son lit. Un vieux carnet de cuir était posé sur le chevet à côté de boîtes de comprimés vides. Elle l’avait ouvert, pensant trouver une explication à son acte. Les pages étaient toutes blanches. Aucune lettre d’adieu n’accompagnait son départ. De toute évidence, ce carnet n’avait jamais servi malgré l’usure de la couverture. Elle avait pourtant souvent vu sa fille le serrer contre elle. C’était à n’y rien comprendre. Peut-être avait-il une valeur sentimentale ? Marc lui avait-t-il offert ? Quelle importance désormais ? Elle l’avait remis à sa place. Elle n’était pas sûre de vouloir comprendre. Sa fille était morte et aucune explication ne la ferait revenir.
Le nez collé à la vitre, elle regardait les champs filer à toute vitesse. Son carnet serré contre son coeur. Il était vide. Vide comme sa mémoire. Ses souvenirs s’effilochaient au fur et à mesure que le train avançait. Le paysage n’était plus que lettres et mots s’effaçant sous une gomme invisible. Elle n’était qu’un être de mots après tout. Les mots qu’elles n’avaient jamais su dire ailleurs que sur des feuilles de papier imaginaires. Les mots qui manquaient à sa vie. Elle n’était pas d’ici et ce train l’emmenait ailleurs. Loin de sa folie.
Petite histoire : "Elle s'écrit" a été publiée dans
que vous pouvez télécharger ICI (j'en profite pour remercier les éditrices, Louve, Lau et Bloody pour la qualité de leur travail :-) )