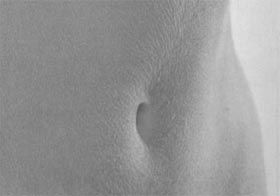LA JUSTICE DE PAIX
Octave Mirbeau
À M. Guy de Maupassant.
La justice de paix occupait, dans la mairie au rez-de-chaussée, une salle donnant de plain-pied sur la place. Rien d’imposant, je vous assure, et rien de terrible. La pièce nue et carrelée, aux murs blanchis à la chaux, était séparée en son milieu par une sorte de balustrade en bois blanc qui servait indifféremment de banc pour les plaignants, les avocats – aux jours des grands procès – et pour les curieux. Au fond, sur une estrade basse, faite de planches mal jointes, se dressaient trois petites tables devant trois petites chaises, destinées, celle du milieu à monsieur le juge, celle de droite à monsieur le greffier, celle de gauche à monsieur l’huissier. C’était tout.
Au moment où j’entrai, « l’audience » battait son plein. La salle était remplie de paysans, appuyés sur leurs bâtons de frêne à courroies de cuir noir, et de paysannes qui portaient de lourds paniers sous les couvercles desquels passaient des crêtes rouges de poulets, des becs jaunes de canards et des oreilles de lapins. Et cela faisait une odeur forte d’écurie et d’étable. Le juge de paix, un petit homme chauve, à face glabre et rouge, vêtu d’un veston de drap pisseux, prêtait une grande attention au discours d’une vieille femme qui, debout dans l’enceinte du prétoire, accompagnait chacune de ses paroles par des gestes expressifs et colères. Les bras croisés, la tête inclinée sur la table, le greffier, chevelu et bouffi, semblait dormir, tandis qu’en face de lui, l’huissier, très maigre, très barbu et très sale, griffonnait je ne sais quoi sur une pile de dossiers crasseux.
La vieille femme se tut.
– C’est tout ? demanda le juge de paix.
– Plaît-y, monsieur le juge ? interrogea la plaideuse en allongeant le cou, un cou ridé comme une patte de poule.
– Je vous demande si vous avez fini de jaboter, avec votre mur ? reprit le magistrat d’une voix plus forte.
– Pargué oui, mossieu le juge… c’est-à-dire, faites excuses, v’là l’histoire… Le mur en question, le long duquel Jean-Baptiste Macé accote ses…
Elle allait recommencer ses antiennes, mais le juge l’interrompit.
– C’est bien, c’est bien. Assez, la Martine, permis d’assigner.
Greffier !
Le greffier leva lentement la tête, en faisant une affreuse grimace.
– Greffier ! répéta le juge, permis d’assigner… prenez note…
Et, comptant sur ses doigts :
– Mardi… nous assignerons mardi… c’est cela, mardi ! À un
autre.
Le greffier clignant de l’oeil, consulta une feuille, la tourna, la retourna, puis, promenant son doigt de bas en haut, sur la feuille, il s’arrêta tout à coup…
– Gatelier contre Rousseau, cria-t-il ! sans bouger. Est-il là, Gatelier et Rousseau ?
– Présent, dit une voix.
– Me v’là, dit une autre voix.
Et deux paysans se levèrent, et entrèrent dans le prétoire.
Ils se placèrent gauchement en face du juge de paix qui allongea ses bras sur la table et croisa ses mains calleuses.
– Vas-y, Gatelier ! Qu’est-ce qu’il y a encore, mon gars ?
Gatelier se dandina, essuya sa bouche du revers de sa main, regarda à droite, à gauche, se gratta la tête, cracha, puis, ayant croisé ses bras, finalement il dit :
– V’là ce que c’est, mossieu le juge… J’revenions d’la foire Saint-Michel, la Gatelière, ma femme, et pis Roussiau, ensemble. J’avions vendu deux viaux et, sauf’ vout’ respect, un cochon, et dame ! on avait un peu pinté. J’revenions donc, à la nuit tombante. Mé, j’chantais, Roussiau agaçait ma femme, et la Gatelière disait tout l’temps : « Finis donc, Roussiau, bon Dieu ! qué t’es donc bête ? qué t’es donc éfant ! »
Et, se retournant vers Rousseau, il demanda :
– C’est-y ben ça ?
– C’est ben ça ! répondit Rousseau.
– À mi-chemin, reprit Gatelier, après un court silence, v’là m’a femme qui mont’ l’talus, enjambe la p’tite hae, au bas de laquelle y avait un grand foussé. « Où qu’tu vas ? » que j’y dis. « Gâter de l’iau, » qu’è m’répond. « C’est ben ! » que j’dis… Et j’continuons nout’ route, Roussiau et mé. Au bout de queuques pas, v’là Roussiau qui mont’ le talus, enjambe la p’tite hae au bas de laquelle y avait un grand foussé. « Où qu’tu vas ? » que j’y dis. « Gâter de l’iau, » qu’y me répond. « C’est ben ! » que
j’dis. Et j’continue ma route.
Il se retourna de nouveau vers Rousseau :
– C’est-y ben ça ? dit-il.
– C’est ben ça ! répondit Rousseau.
– Pour lors, reprit Gatelier, j’continue ma route. J’marche, j’marche, j’marche. Et pis, v’là que j’me retourne, n’y avait personne sus l’chemin. J’me dis : « C’est drôle ! où donc qu’ils sont passés ? » Et je r’viens sus mes pas : « C’est ben long, que j’dis. On a un peu pinté, ça c’est vrai, mais tout de même, c’est ben long. » Et j’arrive à l’endreit où Roussiau avait monté l’talus… Je grimpe la hae itout, j’regarde dans l’foussé : « Bon Dieu, que j’dis, c’est Roussiau qu’est sus ma femme ! » Pardon, excuse, mossieu le juge, mais v’là ce que j’dis. Roussiau était donc sus ma femme, sauf vout’ respect, et y gigottait dans le foussé, non, fallait voir comme y gigottait, ce sacré Roussiau ! Ah ! bougre ! Ah ! salaud ! Ah ! propre à ren ! « Hé, gars, que j’y crie du haut du talus, hé, Roussiau ! Voyons, finis donc, animal, finis donc ! » C’est comme si j’chantais. J’avais biau y dire de finir, y n’en gigottait que pus fô, l’mâtin ! Alors, j’descends dans le fousséj’empoigne Roussiau par sa blouse, et j’tire, j’tire. – Laissemé finir » qu’y me dit. – « Laisse-le donc finir » qu’me dit ma femme. – « Oui, laisse-mé finir, qu’y reprend, et j’te donnerai eune demi-pistole, là, t’entends ben, gars, eune demi-pistole ! » – « Eune demi-pistole, que j’dis, en lâchant la blouse, c’est-y ben vrai, ça ? » – « C’est ben vrai ! » – « C’est juré ? » – « C’est juré ! » – « Donne tout d’suite. » – « Non, quand j’aurai fini. » – « Eh ben, finis. » Et moi, j’reviens sus la route.
Gatelier prit pour la troisième fois Rousseau à témoin.
– C’est-y ben ça ?
– C’est ben ça ! répondit Rousseau.
Gatelier poursuivit.
– V’entendez, mossieu l’juge, v’entendez… c’était promis, c’était juré !… Quand il eut fini, y revint avé la Gatelière sus la route, ous que j’m’étions assis, en les attendant. « Ma d’mipistole ? » que j’demandai. « D’main, d’main, qu’y m’fait, j’ai pas tant seulement deus liâs sus mè ! » Ça pouvait êt’ vrai, c’té ment’rie là. J’n’dis rin, et nous v’l’a qui continuons nout’ route, la Gatelière, ma femme, et pis Roussiau, ensemble. Mé, j’chantais, Roussiau agaçait ma femme, et la Gatelière disait tout l’temps : « Finis donc, Roussiau, bon Dieu ! qu’t’es donc bête ! qu’t’es donc éfant ! » En nous séparant, j’dis à Roussiau : « Attention, mon gars, c’est juré. » « C’est juré. » I’ m’donne eune pognée d’main, fait mignon à ma femme, et pis, le v’là parti… Eh ben, mossieu l’juge, d’pis c’temps-là, jamais y n’a voulu m’payer la d’mi-pistole… Et l’pus fô c’est, pas pus tard qu’avant-z-hier, quand j’y réclamais mon dû, y m’a appelé cocu ! « Sacré cocu, qu’y m’a fait, tu peux ben t’fouiller. » V’là c’qu’y m’a dit, et c’était juré, mossieu l’juge, juré, tout c’qu’y a d’pus juré. »
Le juge de paix était devenu très perplexe. Il se frottait la joue avec sa main, regardait le greffier, puis l’huissier, comme pour leur demander conseil. Évidemment, il se trouvait en présence d’un cas difficile.
– Hum ! hum ! fit-il.
Puis il réfléchit quelques minutes.
– Et, toi, la Gatelière, que dis-tu de ça ? demanda-t-il à une grosse femme, assise sur le banc, son panier entre les jambes, et qui avait suivi le récit de son mari, avec une gravité pénible.
– Mè, j’dis ren, répondit en se levant la Gatelière… Mais, pour ce qui est d’avoir promis, d’avoir juré, mossieu l’juge, ben sûr il a promis la d’mi-pistole, l’menteux…
Le juge s’adressa à Rousseau.
– Qu’est-ce que tu veux, mon gars ? tu as promis, n’est-ce pas ? tu as juré ?
Rousseau tournait sa casquette d’un air embarrassé.
– Ben, oui ! j’ai promis… dit-il… mais, j’vas vous dire, mossieu l’juge… Eune d’mi-pistole, j’peux pas payer ça, c’est trop cher… ça ne vaut pas ça, vrai de vrai !
– Eh bien ! il faut arranger l’affaire… Une demi-pistole, c’est peut-être un peu cher, en effet… Voyons, toi, Gatelier, si tu te contentais d’un écu, par exemple ?
– Non, non, non ! Point un écu… La demi-pistole, puisqu’il a juré !
– Réfléchis, mon gars. Un écu, c’est une somme. Et puis Rousseau paiera la goutte, par-dessus le marché… C’est-y convenu comme ça ?
Les deux paysans se regardèrent, en se grattant l’oreille.
– Ça t’va-t-y, Roussiau ? demanda Gatelier.
– Tout d’même, répondit Rousseau, j’sommes-t-y pas d’zamis !
– Eh ben ! c’est convenu !
Ils échangèrent une poignée de main.
– À un autre ! cria le juge, pendant que Gatelier, la Gatelière et Rousseau quittaient la salle, lentement, le dos rond, les bras ballants.
Petite histoire : Ce texte est paru dans "Les Contes de la Chaumières" (1894).
Pour une rapide présentation d'Octave Mirbeau (1848-1917), vous pouvez, par exemple, aller voir ICI.
Quant aux "contes de la Chaumière", vous en trouverez la version intégrale sur Ebooks libres et gratuits (un vrai trésor, cette bibliothèque en ligne de livres du domaine public...).
 Elle vient le matin
Elle vient le matin